Un nouveau rapport de la RAND Corporation, publié le 17 septembre, a été salué par une partie de la presse outre-Atlantique[1] comme un espoir pragmatique de paix en Ukraine. Ce document, intitulé Guidelines for Designing a Ceasefire in the Russia-Ukraine War (« Lignes directrices pour la conception d’un cessez-le-feu dans la guerre Russie-Ukraine »), propose un ensemble de directives, prétendument concrètes et réalisables, pour concevoir, négocier et mettre en œuvre un cessez-le-feu durable. Il semble présenter toutes les qualités… sauf qu’il est en retard d’une guerre. Celle justement qu’il est supposé aider à résoudre.
Le biais est évident : il est censé offrir aux « décideurs occidentaux, ukrainiens et internationaux » un cadre opérationnel pour arrêter les combats et bâtir une paix viable. Mais il omet un élément essentiel de tout plan de cessez-le-feu : la position de ceux qui sont en position de force sur le champ de bataille. En d’autres termes, les décideurs russes.
C’est, semble-t-il le péché mignon de la RAND, comme celui de nombreux responsables aux États-Unis et en Europe : tenir la Russie pour quantité négligeable, pour un objet à ce point faible et insignifiant qu’il est possible de lui imposer ce que l’on veut sans qu’il ne trouve rien à redire. Cette position était courante en Occident depuis l’effondrement de l’Union soviétique jusqu’à la fin de la décennie 2010 et même au-delà. Certes, les présidents Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama n’affichaient peut-être pas le cynisme décomplexé du sénateur John McCain et d’autres néoconservateurs pour lesquels la Russie n’était qu’« une station-service faisant semblant d’être une nation ». Mais ils avaient oublié la mise en garde de Richard Nixon qui, dans son livre 1999 : La victoire sans la guerre (1988), considérait que les États-Unis étaient bien obligés de tenir compte du seul pays au monde capable de les anéantir.
Cette vision hémiplégique imprégnait un précédent texte de la RAND : Extending Russia: Competing from Advantageous Ground (« Épuiser la Russie : Concurrencer depuis un terrain avantageux[2] »). Publié le 24 avril 2019, ce rapport exhaustif identifiait les vulnérabilités économiques, politiques et militaires de la Russie (baisse des prix des hydrocarbures, sanctions, vieillissement démographique, autoritarisme croissant sous Vladimir Poutine, peurs d'un changement de régime et perte du statut de grande puissance) et évaluait les options pour les États-Unis et alliés afin d'imposer des coûts à Moscou dans cinq domaines : l’économie, la géopolitique, l’idéologie, l’information et le militaire. En Ukraine, l'aide létale (armes et conseillers militaires) était identifiée comme exploitant la plus grande vulnérabilité externe de la Russie, augmentant les coûts de son engagement au Donbass et en Crimée. Pour la RAND, une telle stratégie des États-Unis mènerait à un affaiblissement interne du pays (« overextension ») sans avoir besoin de la vaincre militairement.
Six ans plus tard, on peut constater que c’est bien ce plan de la RAND qui a été mis en œuvre à partir de 2021 par l’administration de Joe Biden et certains membres de l’OTAN, notamment le Royaume-Uni, qui se sont servis de l’Ukraine pour provoquer la Russie et la pousser à ce qu’ils estimaient être une faute fatale. De là venait également leur assurance béate – affirmée en France par Bruno Le Maire – de l’effondrement rapide de l’économie russe. Évidemment, à l’époque, l’erreur principale du rapport était de considérer que le pays était toujours dans un état de faiblesse tragique alors que des travaux universitaires sérieux montraient déjà qu’elle avait surmonté le marasme des années 1990-2000 pour s’engager sur la voie du redressement. Ainsi, en 2021, David Teurtrie pouvait publier un livre au titre explicite : Russie - Le retour de la puissance[3].
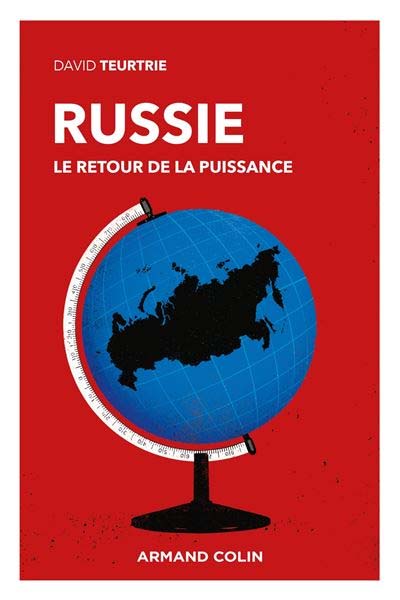 Aujourd’hui, les faits ont démenti prévisions et plans fondés sur les prémisses faussées de la RAND. Non, la Russie ne s’est pas effondrée. Elle n’est pas sur le point de le faire et elle maîtrise le champ de bataille, contrairement à ce que continuent de penser certains dirigeants européens ou responsables étatsuniens. Non seulement ils confondent guerre d’attrition et guerre de mouvement, mais ils semblent vivre dans un univers dystopique, comme le général à la retraite Keith Kellogg, l’envoyé spécial de Donald Trump pour l’Ukraine. Il est persuadé que, en fait, Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre et qu’il sort des chars des musées pour les envoyer sur le front !
Aujourd’hui, les faits ont démenti prévisions et plans fondés sur les prémisses faussées de la RAND. Non, la Russie ne s’est pas effondrée. Elle n’est pas sur le point de le faire et elle maîtrise le champ de bataille, contrairement à ce que continuent de penser certains dirigeants européens ou responsables étatsuniens. Non seulement ils confondent guerre d’attrition et guerre de mouvement, mais ils semblent vivre dans un univers dystopique, comme le général à la retraite Keith Kellogg, l’envoyé spécial de Donald Trump pour l’Ukraine. Il est persuadé que, en fait, Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre et qu’il sort des chars des musées pour les envoyer sur le front !
Or, perseverare diabolicum, c’est bien six ans après ce rapport qui a contribué à conduire l’Occident dans l’impasse stratégique actuelle que la RAND publie ce nouveau texte pour décideurs occidentaux. Que nous dit-il ? D’abord, il préconise des modalités pratiques, fondées sur l’expérience de conflits antérieurs, comme celui de Bosnie en 1995, pour la mise en place d’un arrêt des combats sûr et durable. Il s’agirait d’éviter les erreurs du passé, comme les accords de Minsk 1 et 2, que les auteurs estiment trop flous et ambigus pour être réellement appliqués[4]. Pour cela, la RAND préconise une approche méthodique et anticipative : des groupes d’experts occidentaux devraient concevoir le cessez-le-feu bien avant le début des négociations formelles ; celles-ci devraient aboutir à la rédaction d’un accord contraignant et précis, c’est-à-dire un document exhaustif, spécifiant clairement les rôles et responsabilités de chaque partie. Jusque-là, il n’y a rien à redire, à condition bien sûr que des négociations puissent se tenir.
De même, les mesures proposées pour assurer la durabilité de l’accord ne soulèvent aucune critique particulière si tant est qu’une entente en ce sens soit trouvée avec la partie russe. Le rapport identifie cinq piliers interconnectés, « inspirés des meilleures pratiques historiques » : des zones démilitarisées (DMZ) surveillées par des tiers neutres ; des mesures de renforcement de la confiance (inspections militaires mutuelles, visites de vérification effectuées par des équipes mixtes, surveillance aérienne conjointe) ; un mécanisme de surveillance étendu sur un modèle hybride : missions de surveillance par des forces sous mandat de l’ONU (dans l’idéal) assistées par une infrastructure technologique permanente avancée (satellites, aérostats, points vidéo et drones, le tout géré par une IA). À cela s’ajouteraient des sanctions automatiques en cas de violation.
C’est ici que l’on revient dans le domaine de la pensée magique digne du rapport de 2019. Le texte de 2025 note avec raison que l'Ukraine, affaiblie sur le terrain, a un intérêt clair à négocier. Mais il dit aussi que la Russie reste réticente. En fait, comme on le constate depuis maintenant un an, c’est exactement le contraire : la Russie veut négocier, mais à partir de la situation réelle sur le terrain, ce que l’Ukraine et ses alliés européens refusent de faire. Et voilà ce que préconise la RAND, qui ne semble pas avoir changé de logiciel depuis six ans : pour sortir de l’impasse et forcer la Russie à engager des pourparlers, elle exhorte les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN à montrer une résolution inébranlable : armer l'Ukraine INDÉFINIMENT pour convaincre Moscou que la guerre est intenable à long terme.
Mais – car il y a un « mais » – le rapport précise : « Il reste à voir si l'administration Trump aura la volonté politique de faire en sorte que cela se produise ». C’est évidemment là que le bât blesse : on constate que le pouvoir à Washington multiplie les théâtres d’opérations (en mer de Chine méridionale, au Moyen-Orient, au Venezuela, en mer Rouge et même maintenant, bis repetita, en Afghanistan), sans oublier le front intérieur et la lutte contre les cartels. Bref, partout… sauf en Ukraine. Au vu de ses récentes décisions de réduire le financement étatsunien pour la défense à l’est de l’Europe, le président Donald Trump semble considérer que la protection du Vieux continent est l’affaire des Européens.
Ainsi, le budget proposé pour l'exercice fiscal 2026 (à partir du 1er octobre 2025) prévoit l'arrêt du financement de la BSI, l’Initiative de sécurité baltique (plus d'un milliard de dollars entre 2021 et 2025 en faveur des États baltes). Quant à l'Initiative de dissuasion européenne (EDI), qui finance la présence rotationnelle de troupes américaines en Europe et des projets d'infrastructure comme la modernisation de bases aériennes, elle voit son financement diminuer de 6,5 milliards USD en 2019 à 2,91 milliards proposés pour 2025, avec un avenir incertain pour 2026.
Mais, même en supposant que les États-Unis reviennent à la politique de l’administration Biden et décident d’armer l’Ukraine « whatever it takes and for as long as it takes », on pourrait se demander : pour qui la guerre serait-elle intenable ? Dans un discours le 9 juin dernier, à Chatham House, à Londres, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, expliquait que la production d’armes de la Russie était supérieure à celle de l’ensemble des pays de l’Alliance et qu’en matière de munitions le rapport était de quatre pour un. Certes, des plans européens de réarmement sont en préparation pour des montants astronomiques (800 milliards EUR) et, aux États-Unis, le budget préparé par le Département de la Défense, pardon de la GUERRE, dépasse les 1 000 milliards USD, mais dans le meilleur des cas et en supposant que les programmes soient viables et menés à bien, il faudrait plusieurs années pour parvenir à un résultat. Et, évidemment, pendant ce temps, on imagine benoîtement que la Russie attendra bien sagement de se laisser rattraper et que l’Ukraine résistera vaillamment sans s’effondrer, en trouvant tous les soldats nécessaires pour utiliser les stocks d’armes qu’on finira, un jour, par lui envoyer.
Décidément, pour la RAND, la Russie demeure – et demeurera sans doute ad vitam aeternam – la station-service avec des missiles que l’on décrivait dans les années 1990. Et c’est peut-être à cette vision que, Vassili Nebenzia, le représentant permanent de la Fédération auprès de l’ONU a involontairement répondu en fixant ses lunettes. Un acte manqué ?
[1] Notamment par Responsible Statecraft, généralement mieux inspiré.
[2] En dépit du faux ami, ce titre fait référence à la stratégie de la Guerre froide d’« extended deterrence » ou d’« overextension », popularisée sous Ronald Reagan pour forcer l'URSS à dépenser ses ressources au-delà de ses moyens.
[3] Éd. Armand Colin.
[4] Le rapport semble les considérer comme des accords de cessez-le-feu, alors qu’ils mettaient en place, surtout Minsk 2, des moyens politiques pour régler la question du Donbass.
